Nous recevons cette semaine Marc de Launay, philosophe, chercheur au CNRS, auteur et traducteur de très nombreux livres, qui a participé de près à l’élaboration de Cahier de L’Herne consacré à Walter Benjamin, coordonné par Patricia Lavelle et publié avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Tout le monde connaît aujourd’hui Walter Benjamin : son « enfance berlinoise », son exil à Paris, ses relations tourmentées avec Gershom Sholem ou Theodor Adorno, sa fin tragique en 1940 lorsqu’il échoue à passer les Pyrénées pour fuir le nazisme. Son œuvre est également de plus en plus connue du public français, bien qu’éclatée, dispersée entre de multiples éditeurs comme si la fragmentation, qui est sa marque, était irrémédiable.
Ainsi chacun, parce qu’il a picoré dans son œuvre protéiforme,croit connaître Walter Benjamin suffisamment bien pour pouvoir se dispenser de l’étudier sérieusement. C’est à cette réception paresseuse, dilettante, de Benjamin que les éditions de l’Herne ont voulu remédier en lui consacrant un cahier.
Ce travail collectif de près de 400 pages se veut une approche systématique de l’oeuvre de Walter Benjamin prise dans toutes ses dimensions ; il a été publié avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah sous la coordination de Patricia Lavelle, spécialiste de Walter Benjamin qui enseigne à l’université de Rio, avec l’aide d’un autre philosophe, Marc de Launay, qui est notre invité aujourd’hui.
Liste des contributeurs et des textes compris dans ce volume
![]() Commander le Cahier de l’Herne Walter Benjamin sur le site des éditions de L’Herne (39€)
Commander le Cahier de l’Herne Walter Benjamin sur le site des éditions de L’Herne (39€)
Cet ouvrage a été publié avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

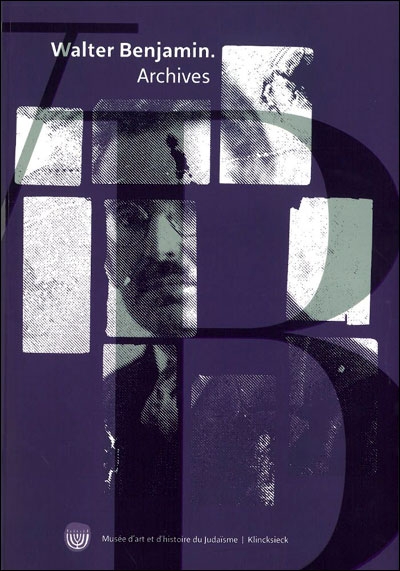 Faire le portrait d’un homme et de sa pensée à travers ses archives, c’est le pari poétique et audacieux de l’exposition actuellement visible au musée d’art et d’histoire du judaïsme, consacrée aux archives de Walter Benjamin, philosophe, écrivain et critique. A travers 13 étapes, c’est un voyage dans la pensée et les traces de l’auteur, par le biais de ce qui reste de ses collections de jouets ou de cartes postales, ses carnets, ceux où il consignait les mots de son fils Stefan, ceux où il notait ses lectures. Le parcours se poursuit au regard de ce qu’il a classé et confié au fur et à mesure de ses déplacements et de l’étau qui se resserrait autour des Juifs. Mais l’exposition est aussi une évocation d’un homme en mouvement, puis d’un homme en exil, qui fuyait les persécutions nazies et n’a pu être sauvé malgré les efforts de ses amis. Walter Benjamin a préféré se donner la mort dans un petit village du sud de la France en 1940, croyant ne plus avoir d’issue, alors même que ses amis lui avaient obtenu un visa d’entrée aux Etats-Unis.
Faire le portrait d’un homme et de sa pensée à travers ses archives, c’est le pari poétique et audacieux de l’exposition actuellement visible au musée d’art et d’histoire du judaïsme, consacrée aux archives de Walter Benjamin, philosophe, écrivain et critique. A travers 13 étapes, c’est un voyage dans la pensée et les traces de l’auteur, par le biais de ce qui reste de ses collections de jouets ou de cartes postales, ses carnets, ceux où il consignait les mots de son fils Stefan, ceux où il notait ses lectures. Le parcours se poursuit au regard de ce qu’il a classé et confié au fur et à mesure de ses déplacements et de l’étau qui se resserrait autour des Juifs. Mais l’exposition est aussi une évocation d’un homme en mouvement, puis d’un homme en exil, qui fuyait les persécutions nazies et n’a pu être sauvé malgré les efforts de ses amis. Walter Benjamin a préféré se donner la mort dans un petit village du sud de la France en 1940, croyant ne plus avoir d’issue, alors même que ses amis lui avaient obtenu un visa d’entrée aux Etats-Unis.